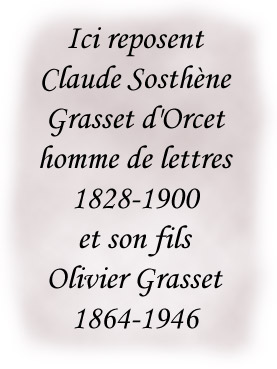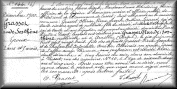|
GRASSET
D'ORCET
Première partie: Biographie
|

Tombe
de Grasset d'Orcet et de son fils
Cimetière
de Cusset - Auvergne |
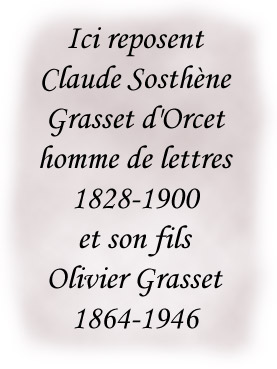
|
| |
| |
INFORMATION
: Le 3ème tôme tant attendu
des Matériaux Cryptographiques réunissant les
articles de Grasset d'Orcet relatifs à la langue des
oiseaux, est enfin sorti. Intitulé "Hiéroglyphie
dans l'Art Antique", il propose 15 articles dans leur format
et typographie originale, réunis par Bernard Allieu.
Il est aussi accompagné d'une étude complémentaire
de Lucie Bonato intitulée "Sosthène GRASSET
et la découverte de l'archéologie chypriote".
300
exemplaires en ont été publiés en début
d'année 2003 par souscription uniquement. Les personnes
intéressées pour s'en procurer ne devraient pas
hésiter à contacter Bernard Allieu à l'adresse
suivante: |
|
|
B. Allieu
Editions Les Trois R
BP
24
78231
Le Mesnil St Denis cedex
Tel:
01 34 61 99 92
"l'Hiéroglyphie dans l'Art Antique": ISBN 2-911129-03-6
L'étude de Lucie Bonato: ISBN 2-911129-03-4
ISBN des 2 volumes: 2-911129-03-2
|
|
| |
Grasset d'Orcet
Grasset
d'Orcet est le mystérieux auteur des articles sur la Langue des Oiseaux
parus dans la Revue Britannique au siècle dernier.
Ami de Fulcanelli, souvent cité par Eugène Canseliet, possible inspirateur
de l'abbé Henri Boudet, son oeuvre n'en est pas moins restée confinée
de nos jours à un petit groupe d'intéressés.
La courte biographie que nous présentons ici est extraite de la préface
du tome 1 des "Matériaux Cryptographiques" rassemblés par
B. Allieu et A. Bathélemy, dont les éléments sont extraits eux-mêmes
de la notice nécrologique consacrée à Grasset d'Orcet en 1901 par
la Revue Britannique:
"Né le 6 juin 1828 à Aurillac
(cantal), il suit des études classiques à Clermont-Ferrand, puis à
Juilly (Seine-et-Marne) et termine son droit à Paris où il fréquente
l'atelier d'un sculpteur avec lequel il acquiert de bonnes connaissances
artistiques. A la mort son père, il entreprend un voyage d'études
sur le pourtour de la Méditerranée, au terme duquel il se fixe à Chypre;
là, il étudie les traces des systèmes cryptographiques de la Grèce
archaïque. Un revers de fortune interrpomts ses recherches archéologiques
et l'oblige à regagner la France où il collabore à différentes publications:
c'est en décembre 1873 que la Revue Britannique accueille un premier
article qui devait inaugurer une série aussi abondante que variée;
nous avons relevé, sur une période de 27 ans, une liste de quelque
160 articles touchant les sujets les plus divers et occupant, pour
les plus longs, jusqu'à 200 pages. Il s'éteindra à Cusset (Allier)
le 2 décembre 1900.
Ses
actes de naissance et de décès révèlent toutefois le nom véritable
du personnage:
"N°
177 - Naissance de Claude Sosthène GRASSET
 |
|
L'an
mille huit cent vingt huit, le six juin, onze heures du matin,
pardevant nous Jean Hippolyte ... , premier adjoint, par délégation
de Monsieur le maire faisant la fonction d'officier de l'état
civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de la préfecture du
Cantal, ont comparu Monsieur Pierre Joseph Grasset, chevalier
de l'ordre impérial de Saint-Wladimir de Russie, membre du conseil
général du département du Cantal, ancien maire de la ville de
Mauriac, âgé de cinquante-trois ans, domicilié dudit Aurillac,
lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né ce matin
à une heure en son hôtel situé rue du Monastère, de lui déclarant
et de dame Antoinette Amélie Athénaïs de Chalambel son épouse,
auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Claude Sosthène.
Les présentes déclaration et présentation faites en présence
de Messieurs Pierre ... François ... ..., propriétaire, ancien
colonel et chef d'état major, des gardes nationales du Cantal
(+), et François Violle, ..., âgé de quarante-neuf ans, domiciliés
du dit Aurillac; et ont le père et les témoins signé avec nous
le présent acte de naissance, après que lecture leur en a été
faite.
(+) âgé de cinquante-deux ans = approuvant le renvoi et un mot
surchargé.
Signatures" |
"N°
145 - Décembre 1900 - [Décès de] GRASSET Claude Sosthène, époux, 72
ans et 5 mois.
| L'An
mille neuf cent, et le lundi trois décembre, à neuf heures du
matin, heure légale; Pardevant nous, Randoingt Pierre, officier
de la légion d'honneur,maire et officier public de l'état civil
de la commune de Cusset, sont comparus en la maison commune:Grasset
Ollivier, Pierre, Joseph, Antoine, Léonard, âgé de trente-six
ans, agent de publicité, fils du décédé, et Massit Théophile,âgé
de trente-un ans, bijoutier, non parent au décédé, domiciliés
l'un et l'autre à Cusset, lesquels ont déclarés que: Grasset
Claude, Sosthène, publiciste, né à Aurillac (Cantal), le six
juin mille huit cent vingt-huit, fils des défunts Grasset Pierre,
Joseph, et de Chalambel Antoinette, Amélie, Athénaïs, son épouse,
époux de Laffon Aimée, Clémence, sans profession, est décédé
hier, deux décembre, à cinq heures du soir, dans son domicile,
à Cusset, rue des Capucins, n° 10, à l'âge de soixante-douze
ans et cinq mois. Après nous être assurés de ce décès, nous
avons dressé le présent acte que nous avons signé avec les comparants,
après lecture faite.
Signatures" |
_ |
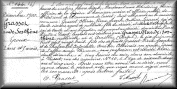 |
Grasset d'Orcet
publiciste
Grasset
d'Orcet fit paraître, à la fin du XIXème siècle, une série d'articles,
principalement dans deux revues : La Revue Britannique
d'Amédée Pichot (plus de 160 articles), et La Nouvelle Revue
de Juliette Adam.
| La
Revue Britannique
fut fondée en 1825 par J.-L. Saulnier, pour vulgariser en France
les meilleurs articles des revues anglaises. A partir de 1851,
elle mêla aux traductions anglaises des articles originaux.
Pierre-Amédée Pichot, qui en prit la direction en 1877, en fit
une revue internationale, mélant aux articles anglais et américains
des traductions d'autres langages. La Revue Britannique
cessa de paraître en 1902. |
|
 |
PICHOT
(Amédée) (Arles 1795 - Paris 1877). Erudit, historien, romancier
et poète. Traducteur de la presque totalité des oeuvres de Byron,
Moore, Shakespeare, Cooper, Walter Scott, Dickens, Macaulay, Bullwer-Lytton,
Thackeray, etc... Auteur de plusieurs ouvrages originaux sur la récit
de ses voyages en Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, et de romans
historiques à la mode de l'époque. Rédacteur en chef de La Revue
Britannique, à partir de 1840. Un monument fut érigé à Aix à l'occasion
de sa mort, et Frédéric Mistral prononça un discours reproduit dans
La Revue Britannique, de 1887, t.3. - LAROUSSE du XXème
siècle
| La
Nouvelle Revue était une publication bimensuelle, politique
et littéraire, fondée à Paris en 1879, par Mme Edmond Adam.
Il s'agissait pour elle de continuer la lutte qu'elle soutenait
depuis 1870 au profit d'idées patriotiques et de progrès. Juliette
Adam recrutait ses collaborateurs parmi les jeunes écrivains
qui donnèrent à cet organe nouveau de l'opinion un mouvement
d'esprit très vivant. |
|
 |
ADAM
(Juliette LAMBER, dame) (Verberie 1836 - Callian 1936). Femme de lettres,
auteur de romans et de souvenirs. Elle épousa d'abord l'avocat La
Messine, puis le politicien Edmond Adam (Le Bec Hellouin 1816 - Paris
1877), député, puis sénateur. Juliette Adam publia de nombreux ouvrages
de souvenirs sur le siège de Paris de 1870. Son salon fut fréquenté
par les littérateurs et les hommes d'état les plus marquants. Elle
accueillit, dans les colonnes de La Nouvelle Revue qu'elle
fonda en 1879, des écrivains comme Pierre Loti. - LAROUSSE du XXème
siècle
Grasset d'Orcet collabora avant 1870 à La Cloche,
au Figaro, et dit du reportage pour l'agence Havas sous la
commune. Ce fut par ailleurs un collaborateur occasionnel des journaux
et revues de l'époque : La France, Le Gaulois,
Le Soleil, L'Orient, Le Monde illustré, et, bien
sûr La Revue Britannique et La Nouvelle Revue.
Son inspirateur, pour sa méthode de Cabale phonétique,
semble avoir été un certain P.-L. de Gourcy, auteur des Lettres
philosophiques publiées à Metz en 1806 (cf article de E. Ch.
Flamand dans Bief Fonctions Surréalistes, paru dans la Revue
du Terrain vague, n°4). Saint-Yves d'Alveydre paraît aussi l'avoir
inspiré notamment dans ses écrits sur les ordres ionique et dorique,
relatant le combat séculaire des Guelfes et des Gibelins (cf « Le
Pacte de famine »).
Joséphin Péladan l'a plagié, sans le citer, dans
« La Clef de Rabelais ». Pierre Dujols l'a nommé dans un
manuscrit datant de 1900, et conservé à la bibliothèque de Lyon, «
La Chevalerie » (Manuscrit n°5491).
Quelques
citations
-
Eugène
Canselier, dans la préface aux Demeures Philosophales de Fulcanelli:
Si
en Héliopolis, je me trouve, toujours et sévèrement soumis par
le serment à l'ancestrale discipline du secret, combien, en revanche,
de hauts personnages, libres et puissants, qui eussent pu parler,
même confidentiellement, se turent, comme liés par un tacite accord!
Il importe qu'on sache, en particulier, que Fulcanelli, dans sa
jeunesse, était reçu par Chevreul, de Lesseps, et Grasset d'Orcet;
qu'il était l'ami de Berthelot et qu'il connut très bien Curie,
son cadet de vingt années, ainsi que Jules Grévy et Paul Painlevé..."
-
Richard
Khaitzine, dans Fulcanelli et le Cabaret du Chat Noir, p. 158-159:
"L'érudit
Grasset d'Orcet [...] fit de bien étranges allusions dans ses
travaux. Persuadé que nombre d'oeuvres littéraires, aussi bien
parmi celles qui furent contemporaines qu'au sein des classiques,
mais aussi picturales, étaient des oeuvres symboliques qu'il convenait
de décrypter, Grasset d'Orcet appliqua sa méthode également à
la presse. Il s'évertua à décrypter les dessins des journaux satiriques
et illustrés de l'époque: Le Don Quichotte, Le Gil
Blas, Le Courrier Français, et Le Chat Noir, tous
journaux qui étaient sous la direction occulte de Louis Legrand
(Franc-Nohain) et de Caran d'Ache (Emmanuel Poiré). Selon Grasset
d'Orcet, les planches de Caran d'Ache devaient se lire suivant
les règles du rébus ou de la charade. Ce même auteur laissait
entendre que lesdits journaux auraient eu un rôle à jouer concernant
la petite correspondance secrète de certains services spéciaux
français."
-
Le
poème de Raymond Roussel, intitulé La Meule, est dédié à Verax
et contient en acrostiche le nom d'Orcet, ainsi qu'une invitation
à repasser cet auteur .
Quelques coïncidences...
-
Grasset
d'Orcet a suivi une partie de ses études au collège de Juilly
(Seine et Marne), vraisemblablement vers les années 1840, compte
tenu de sa date de naissance.
Or, le 22 octobre 1840, l'abbé Constant (le futur Eliphas Lévi)
y fut nommé répétiteur par le Directeur de cet établissement qui
était alors ... l'abbé Henri de Bonnechose, futur évêque de Carcassonne
(1847), d'Evreux (1854) et futur archevêque de Rouen (1858) (ce
même abbé sera plus tard impliqué dans la légende de Rennes-le-Château).
Ce fut à Juilly que Constant rédigea sa Bible de la Liberté.
-
Eliphas
Lévi fut l'ami d'Edward Bulwer-Lytton, Grand Maître de la Société
Rosicrucienne pour l'Angleterre, et auteur de plusieurs romans
initiatiques. Or, le premier traducteur des oeuvres de Lytton
en français fut Amédée
Pichot, rédacteur en chef de La Revue Britannique.
D'ailleurs, la première traduction française de L'Etrange Histoire
de Bulwer-Lytton parut dans La Revue Britannique, de novembre
1861 à août 1862. Le traducteur en était bien sûr Amédée
Pichot, ami de Grasset d'Orcet.
Lectures en ligne
et téléchargement
Une interprétation ésotérique de l'histoire
de la Révolution française chez Grasset d'Orcet (1828-1900),
par Jean-Claude DROUIN
Document
téléchargeable au format PDF compressé
(Cliquer
avec le bouton droit de la souris pour sauvegarder le fichier sur
votre disque)
 intrprt_eso_histoire.zip (58 kb)
intrprt_eso_histoire.zip (58 kb)
L'imaginaire
de la nation chez l'ésotériste Grasset d'Orcet (1828 - 1900),
par Jean-Claude DROUIN
Document
téléchargeable au format PDF compressé
(Cliquer
avec le bouton droit de la souris pour sauvegarder le fichier sur
votre disque)
 imaginaire_nation.zip (30 kb)
imaginaire_nation.zip (30 kb)
La
Chevalerie, par Pierre DUJOLS (ami de Fulcanelli, voire
une face de Fulcanelli lui-même, citations de Grasset d'Orcet)
Document
téléchargeable au format PDF compressé
(Cliquer
avec le bouton droit de la souris pour sauvegarder le fichier sur
votre disque)
 chevalerie_dujol.zip (34 kb)
chevalerie_dujol.zip (34 kb)
La
Clef de Rabelais. Le secret des corporations, par Joséphin PELADAN-
Paris, E. Sansot, 1905
Ce livre, fortement inspiré d'une étude de d'Orcet sur Rabelais,
est téléchargeable sur le serveur Gallica
de la Bibliothèque Nationale de France (y consulter la liste
des auteurs) ou disponible directement sur le présent site.
Document
téléchargeable au format PDF compressé
(Cliquer
avec le bouton droit de la souris pour sauvegarder le fichier sur
votre disque)
 clef_rblais.zip (5 Mo)
clef_rblais.zip (5 Mo)
Editeurs
-
Nous donnons ici l'adresse du premier éditeur
de d'Orcet, bien que les tômes restants des Matériaux Cryptographiques
se fassent rares (qualité de reproduction irréprochable). A remarquer
début 2003 la publication d'un nouveau tômes d'articles
dans leur format original:
B.
Allieu
Editions Les Trois R
BP
24
78231
Le Mesnil St Denis cedex
Tel:
01 34 61 99 92
-
Enfin, les éditions
E-dite Essai ont récemment
publié une série d'ouvrages regroupant des articles par thèmes:
Histoire secrète de l'Europe, Tomes I et II
L'archéologie mystérieuse, Tomes I et II
Oeuvres décryptées, Tomes I et II
Chroniques et récits d'Auvergne
La croix de verre
Rien que pour les excellentes préfaces biographiques de Jean-Pierre
Deloux et Michel Aulonne ces recueils d'articles en valent la peine:
Préface à l'Histoire Secrète de l'Europe,
Tome I, Edition E-dite, Juin 2000
| GRASSET D'ORCET, L'HERMETISME
INCONNU
Cité par
Fulcanelli, Canseliet et quelques autres rares adeptes ou Frères
d'Héliopolis, pillé par des érudits ou chercheurs moins
scrupuleux, Claude-Sosthène Grasset d'Orcet (1828-1900) fait
toujours figure de noble voyageur énigmatique, au même titre que
le comte de Saint-Germian. L'homme semble aussi irréductible
qu'incernable, à la mesure d'une oeuvre qui, entre autres révélations,
éclaire d'une lumière singulière les ténèbres de l'Histoire
officielle en prétendant lui substituer une histoire secrète
plus séculaire qui en serait la cause.
De quoi faire
grincer les dents de tout rationaliste, et d'agacer l'historien de
profession préoccupé surtout d'accumuler des matériaux. Grasset
d'Orcet n'a que faire des archives ou témoignages: il prétend
s'abreuver à la source même. Non pas en faisant appel à de mystérieux
initiés (initié, il le fut certainement: son savoir l'atteste)
mais à ce qui subsiste de ce savoir, d'une connaissance dont le
fond et la forme ne font qu'un, c'est-à-dire aux vestiges
toujours vivants, et donc parlants, du passé: les oeuvres d'art
et, plus particulièrement, celles que l'on peut rencontrer
quotidiennement en visitant églises et cathédrales.
Un art religieux
qui, en réalité, exprime la réalité de l'art populaire, la vérité
des constructeurs, des tailleurs de pierres, des maçons et autres
maîtres d'oeuvres appartenant à toutes les corporations de métiers.
Ces grands livres de pierres, dont il faut lire la statuaire à la
manière des rébus, charades et autres jeux de mots, contiennent
leur part de vérité éternelles.
De même, les
productions à vocation strictement artitstiques destinées à
l'aristocratie, véhiculent sous la même forme cryptée différents
messages de même nature, politiques, historiques, philosophiques
ou métaphysiques.
Selon une
cryptographie identique, il est permis aussi d'appréhender bien
des oeuvres littéraires ou picturales (les tableaux ayant eu la
part belle dans la diplomatie occulte car ils permettaient de
transmettre différents messages connus des seuls initiés.
L'exemple le plus considérable étant l'utilisation du thème de
l'Arcadie, et les variations de Poussin, du Guerchin, ...). Un des
grands mérites de Grasset d'Orcet est d'avoir déchiffré cette
"langue diplomatique", qui, jusqu'au XIXème siècle fut
couramment utilisée pour véhiculer des informatiosn réservées.
Malheureusement, s'il nous en livre ici et là les principales
clefs, il ne nous cache pas non plus que ce grimoire secret, fondé
sur des calembourgs, des amphibologies et des à-peu-près en
vieille langue d'oil, est très difficile à démêler pour un
lecteur moderne.
L'idée de secret
irrite l'historien qui se refuse à considérer que le fondement
même de l'Histoire, la politique, ne peut que relever du confidentiel;
et que, selon cette perspective, la véritable histoire ne
peut être que dissimulée. Critère apparemment incompatible
avec l'idée même de démocratie impliquant une transparence
que, par ailleurs, les régimes démocratiques n'appliquent
guère. Il suffit pour s'en persuader de réfléchir quelque
peu à l'histoire des deux derniers siècles...
La démarche de
Grasset d'Orcet est donc une véritable provocation à l'encontre
de nos dogmes et croyances issues de la logique et du rationalisme
chers à l'homme occidental depuis les Lumières (la véritable
étant mise sous le boisseau, si tant est qu'il en existe une).
Nul doute qu'aujourdhui, son oeuvre ne se heurte au spectre
du politiquement correct, dont l'ambition est de devenir le
prêt-à-porte de la pensée, tout en instiguant une manière
de fascisme ordinaire reposant sur l'autocensure et le totalitarisme
mou du socialolibéralisme ambiant.
Il est donc
salutaire sinon indispensable de faire connaître les travaux si
divers de notre auteur, difficiles à consulter en bibliothèque et
publiés essentiellement en revue, à l'exception de deux volumes
à tirage limité regroupant différents articles sous le titre de
Matériaux Cryptographiques, recueillis et édité par
Bernard Allieu et A. Barthélémy en 1979.
* * *
Claude-Sosthène
Grasset d'Orcet est néle 6 juin 1828, à Aurillac (Cantal), dans
l'hôtel particulier familial, sis rue du Monastère: Son père;
Pierre-Joseph Grasset (1774-1849) appartenait à une vieille lignée
dauphinoise. Fils d'un maître de forges d'Allevard, à la limite
de l'Isère et de la Savoie, il était le cadet de douze enfants.
Il comptait dans son entourage proche le trio d'avocats grenoblois
élus à l'Assemblée Constituante: Mounier, auteur du serment du
jeu de Paume puis président de la Constituante, et Guerre-Dumolard
étaient ses cousins germains; ce dernier était aussi son parrain
(il s'appelait en réalité Guerraz, et Grasset d'Orcet utilisa
plus tard son nom comme pseudonyme pour signer de nombreux
articles).
Quant au troisième,
Antoine Barnave, un temps maire de Grenoble et président de la
Constituante, c'était avec Mirabeau le plus brillant orateur de
son temps. Commissaire de l'Assemblée chargé de ramener la
famille royale de Varennes, il se lia avec elle et s'improvisa le
conseiller de Louis XVI. Quand on ouvrit la fameuse armoire de fer
du roi contenant sa correspondance secrète, il fut mis en
accusation et arrêté. Son transfert à Paris en août 1792
provoqua une émeute de jeunes grenoblois, parmi lesquels son ami
et élève Pierre-Joseph Grasset. Pris "les armes à la
main", le jeune homme ne dut son salut qu'à l'intervention
de l'épouse du général commandant la place. Enrôlé dans l'armée,
il fut bientôt envoyé en mission de réquisition en Auvergne.
C'est là qu'il finit par s'établir, à Mauriac (Cantal), ville
dont il fut le maire et conseiller général sous Napoléon, la
Restauration et la monarchie de Juillet.
Pierre Grasset
se maria une première fois avec Jeanne-Marie Delsol de Volpilhac,
veuve de Barthélémy de Vigier, seigneur d'Orcet, lieutenant au régime
de dragons d'Orléans et receveur des tailles de l'élection de
Saint-Flour, puis trésorier de France par la grâce de Madame Du
Barry qui fut vraisemblablement sa maîtresse. Ce mariage
singulier avec une veuve de soixante-onze ans assura sa fortune,
une rente de quelque 60 000 livres, même si le testament fut
contesté par les héritiers De Vigier.
En secondes
noces, il épousa Antoinette de Chalembel (1806-1837), de la maison
d'Escorailles par son grand-père maternel, petit-neveu de la
duchesse de Fontanges, Marie-Angélique de Scorailles, maîtresse
de Louis XIV. Cette maison descendait de Waïfre d'Aquitaine, un
des derniers princes mérovingiens, assassiné en 738, après
avoir combattu aux côté de Charles Martel lors de la
providentielle bataille de Poitiers, ce qui fait de cette souche
une des plus anciennes attestées en France.
L'enfance de
Claude-Sosthène, né de ce second lit, se passa entre Mauriac, à
l'hôtel d'Orcet, aujourd'hui encore siège de la sous-préfecture
du Cantal, et Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme) chez sa grand-mère.
Il fit ses études au petit séminaire de Clermond-Ferrand, puis
chez les Oratoriens de Juilly, école fort réputée, avant de les
achever au Lycée Saint-Louis, puis à la Faculté de Droit de
Paris.
Ce jeune
provincial aisé et d'esprit curieux se met alors à fréquenter
le monde artistique. Il se lie ainsi, au café de la Régence,
place du Palais Royal, avec Alfred de Musset, Théophile Gautier,
Barbey d'Aurevilly, Henri Murger. Il étudie aussi à l'atelier du
sculpteur Elias Robert, où il s'initie aux arcanes des
beaux-arts.
En 1848, il
participe aux terribles journées de juin au sein de la dixième légion,
dirigée par le marquis de Saulcy, avec lequel il se lie d'amitié,
en raison de leur goût commun pour l'archéologie.
L'année
suivante, le décès de son père lui assure son indépendance matérielle.
Se consacrant désormais entièrment à sa passion pour les arts,
il liquide peu à peu ses biens et entame pour quinze années un
long périple qui le conduit d'abord en italie, à Vienne, en Grèce,
en Bulgarie puis à Constantinople. S'arrêtant au gré de ses
impressions, il écume les pays ottomans, Syrie, Liban, Egypte. On
le trouve à Malte, Saïda, Tunis, Corfou, ... A l'occasion d'une
partie de chasse, dont il est grand amateur, il découvre Chypre.
Enthousiasmé par la richesse du patrimoine historique et la
splendeur de l'île, dont il dira plus tard "qu'on y trouve
les plus beaux paysages de la Méditerranée", il décide de
s'y fixer pour un temps.
Rapidement intégré
à la minuscule communauté française, il obtient une sinécure
d'agent consulaire à Famagouste, port près duquel il réside, à
Aghios Serghios. Il épouse la fille d'un ancien médecin-major de
l'armée française établi à Nicosie, Aimée Laffon, qui lui
donnera deux enfants.
A cette époque,
Chypre est encore quasiment terra incognita pour les archéologues:
notre homme a donc tôt fait de se constituer une belle collection
d'une vingtaine de statues archaïques et classiques, qui seront
la base du fonds cypriote du Louvre. Mais son plus grand sujet de
gloire reste la découverte du célèbre cratère d'Amathonte,
pesant près de quinze tonnes, qui lui vaut le titre de
vice-consul de France honoraire. Il n'en sera pas moins lésé, le
prestige de sa trouvaille et de son acheminement vers le sol
national allant à d'autres. De plus, pris par ses activité,
Grasset d'Orcet néglige ses affaires, essuie un grave revers de
fortune consécutif aux guerres d'Italie, et, pour comble, se fait
rouler par des aigrefins lors de l'achat de machines à égrener
le coton.
C'est à ces
malheureuses péripéties que nous devons son oeuvre car, sans
elles, il serait resté ce qu'il avait été jusque là, un oisif
amateur d'art éclairé. Ruiné, il rentre donc en France en 1865
avec sa famille et vivra désormais péniblement de sa plume.
Avant 1870, il collabore à La Cloche, et au Figaro,
ainsi qu'à l'Agence Havas. Sous la IIIème République, il
écrit à La France, au Soleil, à la Nouvelle
Revue, au Monde Illustré. Pendant plus de dix ans, il
sera rédacteur en chef de L'Orient, organe de presse turc
à Paris, ce qui lui vaudra en 1899 une des plus hautes
distinctions ottomanes, le Medjidié de troisième classe.
Enfin, à partir de 1873, il entame une collaboration avec la
Revue britannique qui durera jusqu'à sa mort.
Toute cette période
de la fin de sa vie n'est guère heureuse: Il doit travailler durement
pour survivre avec peine. De plus, cet homme sans concessions ne
trouve pas place dans les cénacles littéraires. En 1879, retenu
à Paris, il ne pourra même pas assister aux derniers moments de
sa fille adorée Edmée, emportée à 19 ans par la phtisie
galopante, épisode déchirant qu'il relatera dans une de ses
nouvelles, la Chiberli. Dès lors, seul son labeur lui
apportera un peu d'oubli à défaut de consolation. Il trouve tout
de même le temps d'entretenir une correspondance considérable,
malheureusement perdue, avec ses rares amis, le commandant du Génie
Levet, le comte d'Hérisson, Claudius Popelin, ...
Grasset d'Orcet
meurt le 2 décembre 1900 à Cusset (Allier) après une longue
maladie, en présence de son épouse et de son fils Olivier. Il
laisse à la postérité plus de 700 articles sur les sujets les
plus divers, géopolitique, économie, histoire, diplomatie, ...
des romans, des nouvelles et des monographies. Grand reporter
avant la lettre, spécialiste du monde méditerranéen et du Moyen-Orient,
il a, par de fines analyses, prévu la constitution du bloc soviétique,
la montée du syndicalisme et des idées marxistes, l'écroulement
des empires turc et austro-hongrois, l'émergence de l'Islam, etc.
Mais ses sujets
de prédilection demeurent les aspects secrets et inconnus de
l'histoire occidentale, et plus particulièrement du Moyen Age et
de la Renaissance, quand corporations et corps de métiers étaient
structurés et possédaient leurs secrets techniques,
professionnels et initiatiques, quand le travail avait encore un
sens et une finalité non économique, quand le travail manuel n'était
pas méprisé...
A cet égard
Grasset d'Orcet partage les idées et idéaux traditionnels; il
devance les conclusions d'un René Guénon privilégiant la qualité
et dénonçant le règne de la quantité ou bien celles encore
d'un Jean-Charles Pichon désignant clairement le conflit sans fin
du Prince et des Egaux.
Cet
appauvrissement de l'objet est lié à celui de l'idée, que l'on
peut aussi traduire par l'appauvrissement du langage, et plus
particulièrement des argots dont les bases étaient la fameuse
cabale phonétique ou langue des oiseaux. Grasset d'Orcet nous en
enseigne les rudiments et les nromes fort complexes, laissés en
partie à l'imagination de chacun. Cette richesse des mots et de
la pensée était bien sûr à la mesure du savoir technique, l'un
conditionnant l'autre.
L'on comprend
mieux, aujourd'hui, pourquoi les choses sont désormais muettes;
pourquoi l'art n'exprime plus rien, à part son néant, notre
propre néant. Le dépérissement de la langue conditionne celui
de l'imaginaire et de la création. Puissance du verbe...
[...]
Jean-Pierre Deloux
|
Références des
principaux écrits de Grasset d'Orcet et articles à télécharger
|